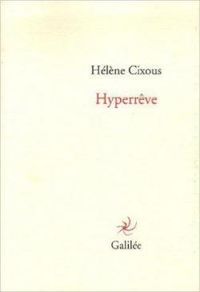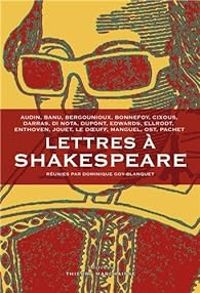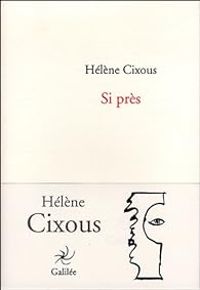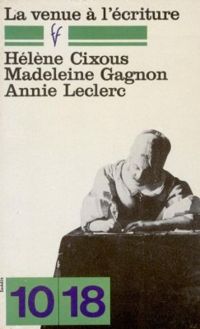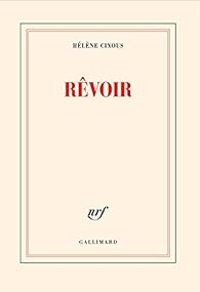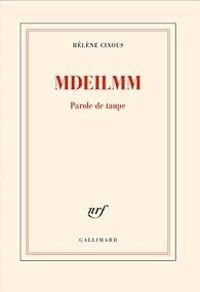Hyperrêve
Au début d’Hyperrêve, la question est posée : « Dans l’obscurité je descends le bel escalier silencieux. Est-ce que je rêve ? Suis-je éveillée ? »[2]. Tout d’un coup quelque chose se passe ; quelqu’un arrive. Mouvement très brutal ; le voile se déchire – ou alors il se replie, menaçant, sur la promeneuse ou le promeneur, le rêveur ou la rêveuse – l’enveloppe – comme un serpent. La chambre s’effondre sur elle-même, le sol se dérobe. Elle note le (non)raisonnement suivant : « Donc je rêve. Donc je ne rêve pas : c’est bien un rêve qui se passe en réalité. » [3]. Contrepied en pirouette de Descartes. Lui qui, pour se sortir du doute, a édifié un escalier qui mène tout droit à Dieu. On connaît l’astuce. Si vous êtes perdus dans une forêt, dit-il encore, tracez une ligne droite.
L’escalier ici n’est pas la scala cartésienne ; c’est un escalier en colimaçon, un escalier à la Montaigne qui s’enroule infiniment sur lui-même : « les escaliers en bois en centaines de marches, qu’on ne peut emprunter, pliées en rouleaux serrés, renversés... Il faut grimper, ramper… »[4]. Si vous êtes perdus dans une forêt, tournez le plus possible en rond : vous pouvez, vous devez, vous devez pouvoir vous perdre encore plus : vous perdre jusqu’à vous trouver. C’est ça, dedans, le couloir à parcourir, un couloir long d’un an au moins mais d’un an qui veut dire mille ans d’un an qui contient des siècles des siècles qui contiennent des millénaires, un sentier qui frôle plusieurs falaises : une falaise blanche brûlée ravinée, qui se jette dans la mer méditerranée, et jamais la mer n’a été aussi bleue ; et des chemins jaunâtres, couverts de ronces, de nœuds d’épines, qui se tordent dans toutes les directions.
Quelque soit le chemin, le ravin, le sans-fond, l’enfer, on y tombe, encore griffés, lacérés, on tombe. On tombe dans le noyau brûlant du « neutre », un « neutre » différent de celui de Blanchot, froid, blanc, murmurant[5] ; ce « neutre » est strié, parcouru de voix, de cris, de figures hallucinantes, effrayantes et adorables. Grêle dans l’univers. Frelons. Fourmis ailées. Espaces, raccourcis, couloirs. Escaliers, colimaçons. Fuyards, souvenirs, ombres, fantômes, dents, fémurs, crânes. Grondements de tonnerre. Lierres, leurres qui grimpent dans le cœur. C’était l’automne à peine, je pense, quand lisais les textes les plus fous, un automne en flots d’ébène et pluie sur le bleu clair de la piscine déserte. Lieux où « rien n’a lieu… » Géographie labyrinthique : Manhattan, Osnabrück, Alger, Oran : villes-signifiants, Villes majuscules, pleines de chambres, de trappes, de raccourcis magiques – comme dans ces gravures d’Escher où les couloirs se plient, s’ouvrent, donnent encore sur des escaliers infinis.
Le chaos est défini « moins par son désordre que par la vitesse infinie avec laquelle se dissipe toute forme qui s’y ébauche » (Deleuze[6]) ; tout va de plus en plus vite, tout se confond, tout change sans qu’on ait pu arrêter une détermination. Les règnes, les genres, tout se mêle, tout communique. Tout participe. Temps, espace, « out of joint » : on crève le transcendantal ; les formes de la perception (se) débloquent. Tout part de la langue : le changement d’une lettre, son renversement, son ouverture, comme l’ouverture d’une brèche, d’une fissure – ou, à l’inverse, le déroulement d’une phrase qui bouge, inspire, expire, se plie, se contracte, se détend, une phrase qui semble l’air, la vie même, qui enlace, serre, reprend et ressaisit l’hétérogène, l’incompréhensible : même en discontinu, c’est bien une seule ligne, un seul tissu métaphysique, poétique, qui relie le tout.
Mouvements dans la langue qui ont une répercussion dans la structure de la perception. De la voix au phénomène : au travail dans l’écriture, un constant « affinement perceptif » de l’ouïe, du regard et de la sensation, proche à l’ « approximation de la vérité » dans l’art de la peinture : donner la vie par un seul trait (Hokusai) ; capter la lumière, son rebondissement sur l’objet l’approcher progressivement, par précisions et repprécisions infinies, infinitésimales, dans une retouche, une reprise, une attention à chaque détail (Cézanne). Ce qui ferait signe vers un autre mot-clef : « l’art de penser ».
Des temps immémoriaux et mythiques d’où elle se soulève, son « écriture stroboscopique »[7] court dans un monde technologique et frénétique ; elle dit déjà l’alliance de la pensée et de la machine, la vitesse hyperaccélérée des images. La « lumière du rêve » frappe par flashs les objets qu’elle touche, les découpe, les montre dans une temporalité déchaînée, paradoxale.
La pagode d’Osnabrück entrevue « à la lisière du rêve » : « éternelle et en ce moment si cruellement mortelle, comme une chose de beauté bientôt perdue dans le fouillis de la ville, à moitié engloutie et cependant flottant encore comme un papillon au-dessus de la mer de béton »[8]. Comme un écho de Rimbaud pris dans une vision d’Orient, un papillon, un pavillon. Ou le cyprès, image foudroya