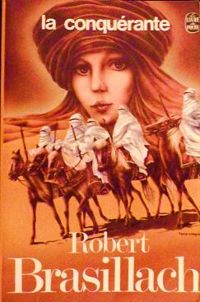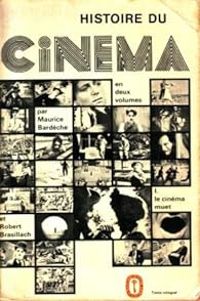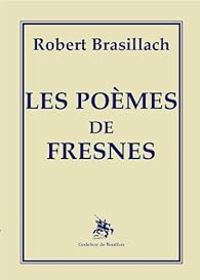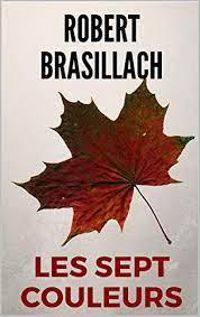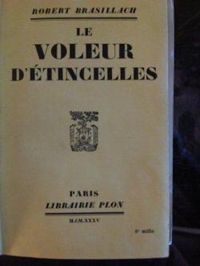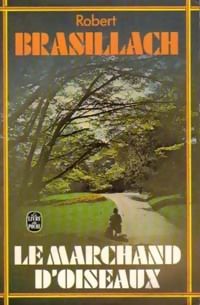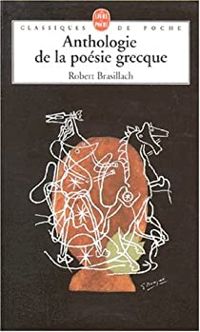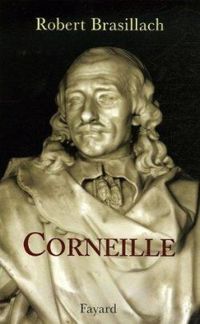La conquérante
On ne dit jamais adieu à la jeunesse. On a beau faire semblant de s'en séparer, elle ne se détache pas du cœur de l'homme. Quand l'âge de la trentaine nous visite, nous savons que nous devons établir le premier bilan et regarder se dissoudre les souvenirs et les fantômes. Nous pensons à ce que nous fumes, et, pour que les feux anciens ne s'éteignent pas, nous ravivons leurs lueurs dans notre vie et dans des existences encore plus exténuées que les nôtres.
Telle est bien la pensée qui prédisposa Brasillach à écrire La Conquérante : il voulait y affirmer que le temps n'a pas de prise sur la jeunesse, qu'il n'estompe pas les traits d'un âge d'or, mais qu'au contraire il les souligne en les rendant plus irréels et troublants encore et, pour tout dire, que la jeunesse est un don de la mémoire.
Quelle vie, quelle adolescence l'écrivain parvient-il à ressusciter ? Ici, ce n'est pas la sienne, mais celle de sa mère et de son père. Il s'avance à tâtons dans une contrée de prédilection, de Marrakech à Rabat, en un pays d'ombres qu'éclairent seulement les récits des anciens jeudis. On marche dans le sable, suivi par un miroir de soleil. Comment savoir où l'on va ? Tout est à faire : les villes à élever, les consciences à éclairer, les chemins à tracer et les cœurs à attendrir.
Voici surtout Brigitte. Ce qui l'entoure, le Maroc de Lyautey, le désert, les cavaliers rebelles, les routes dans la nuit, la solitude et la menace. Cette provinciale, promue à la dignité de déesse africaine, ne serait-elle pas la personnification idéale de la femme, du courage et de la tendresse ?