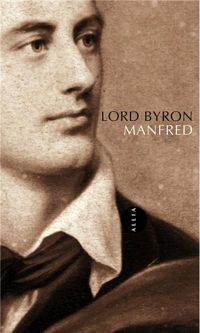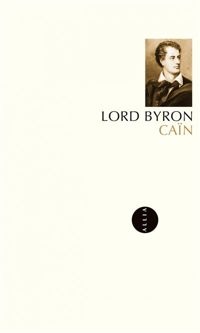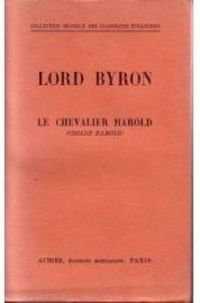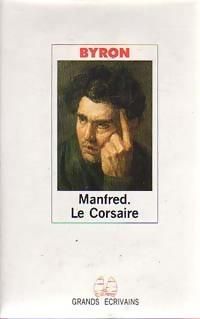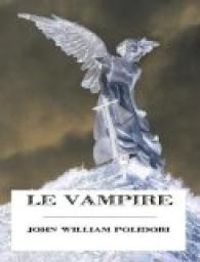Journal de Ravenne
“Ce journal est un soulagement. Quand je suis las — ce que je suis généralement — quelque chose jaillit et ensuite tout se déverse. Mais je suis incapable de le relire et Dieu sait quels embrouillaminis il peut contenir. Si je suis sincère avec moi-même (mais je crains qu’on ne se mente à soi-même plus encore qu’on ne ment à quiconque) chaque page paraît brouiller, réfuter et complètement abjurer la précédente”.
Ces lignes, valables pour tous les journaux intimes de Byron, peignent bien le jaillissement verbal qui, sous l’afflux des pensées, peu à peu les tisse. Ici la prose, parfaitement spontanée et d’une parfaite justesse d’expression tout ensemble, est comme une force de la nature à laquelle on n’échappe pas tant qu’elle s’exerce. Incomparable en cela, elle ne se veut pas musique de sons et de sens comme chez tel ou tel prosateur célèbre, mais elle implique, elle évoque immédiatement une présence : Byron est là qui enregistre, s’interroge, se rappelle. L’illusion est plus forte, me semble-t-il, que chez tout autre auteur de journaux intimes.
C’est assurément l’une des meilleures approches possibles de Byron pour des lecteurs français qui, par un caprice continental de la mode, ne connaissent plus guère aujourd’hui que son nom.
On trouvera ici non pas l’ensemble de ses journaux intimes, mais in extenso, le Journal de Ravenne, cette chronique de 1821, année cruciale et particulièrement féconde de sa vie d’exilé volontaire ; puis les Pensées détachées de Ravenne et de Pise ; puis, leur succédant tout de suite dans le temps vécu, le Journal de Céphalonie et les quelques notes ultimes de Missolonghi.
P. Leyris